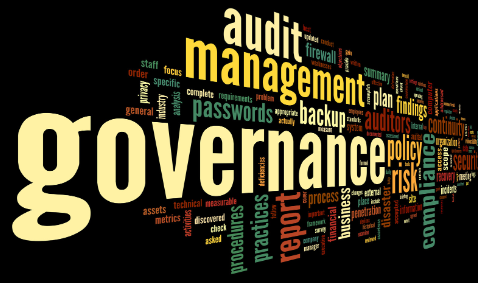Conseil d’État, 10ème – 9ème chambres réunies, 18/10/2024, 473828
Le principe de cristallisation des règles d’urbanisme de l’article L 442-14 du code de l’urbanisme est considéré comme une garantie très importante pour les lotisseurs et les colotis en ce qu’il les protège d’une évolution défavorable des règles d’urbanisme après l’obtention d’une autorisation de lotissement (permis d’aménager ou déclaration préalable). Il a toujours soulevé de belles questions pratiques. Les plus anciennes concernent par exemple le point de départ de la cristallisation et du délai de cinq ans en permis d’aménager avec travaux (ou… sans travaux) ou encore la possibilité de panachage des règles d’urbanisme susceptibles d’être appliquées aux permis de construire dans le lotissement, selon leur caractère plus ou moins favorables aux projets de construction…
La jurisprudence ayant (logiquement) rappelé que la cristallisation était perdue en cas de caducité du permis d’aménager ou de la non-opposition à déclaration préalable, les opérateurs et les collectivités sont confrontés depuis quelques années à de nombreux contentieux engagés par des tiers, extérieurs à un lotissement autorisé (voire par certains colotis…), qui cherchent à contester des permis de construire en invoquant la péremption du permis d’aménager ou de la non-opposition à déclaration préalable, lorsque les règles d’urbanisme ont évolué défavorablement (par exemple lorsque la hauteur maximale a été abaissée ou plus radicalement lors que le terrain loti se retrouve dans une zone inconstructible…). Le Conseil d’Etat ayant écarté le bénéfice de la cristallisation en l’absence de tout transfert de propriété ou de jouissance des lots créés par l’opération (Cf. son arrêt du 13 juin 2022, n°452457), il a été jugé que la seule signature de promesses de vente dans le délai de validité de l’autorisation ne suffisait pas – ou peut être pas dans tous les cas selon le contenu de la promesse- pour éviter la caducité et l’application de règles postérieures défavorables (Cf. CAA de Lyon, 30 avril 2024, n° 22LY02695).
De même, a été portée au contentieux une autre thèse selon laquelle le lot faisant l’objet du permis de construire devait, pour bénéficier de la cristallisation, avoir lui-même fait l’objet d’un transfert en propriété ou en jouissance dans le délai de validité de l’autorisation de lotissement. Nous avions obtenu du Tribunal administratif de Lyon qu’il rejette cette argumentation. Dans son arrêt du 18 octobre 2024, mentionnés au table du recueil Lebon, le Conseil d’Etat confirme cette position : il juge clairement, d’une part, que le lotisseur n’a pas à transférer la propriété ou la jouissance de tous les lots du lotissement dans le délai de validité de l’autorisation du lotissement et, d’autre part, que peu importe si le lot objet du permis de construire n’a pas lui-même fait l’objet d’un tel transfert.
Cet arrêt, important pour les opérateurs, ne statue pas sur la question des lotissements ne donnant lieu qu’à la signature de promesses dans le délai de validité de l’autorisation. Dans sa décision, le Conseil d’Etat vise toujours, dans la continuité de son arrêt du 13 juin 2022, la nécessité de transferts en propriété ou en jouissance dans le délai de validité de l’autorisation de lotissement, sans évoquer l’hypothèse de lotissements avec promesses de vente, qui ne se présentait pas dans cette affaire.
Mais, très pragmatiquement, cet arrêt permet aux lotisseurs de conserver leur autorisation et le bénéfice de la cristallisation pour tous leurs acquéreurs dès lors « qu’une partie au moins des lots » a fait l’objet d’un transfert de propriété ou de jouissance dans le délai de validité du permis d’aménager ou de la non-opposition à déclaration préalable. La situation particulière de cette affaire, qui donne à cet arrêt un intérêt pratique supplémentaire, tient au fait que la cristallisation a ainsi bénéficié… à un permis de construire déposé sur le seul lot des quatre du lotissement autorisé qui était destiné à être bâti et que c’est précisément ce lot à bâtir qui n’avait pas fait l’objet d’un transfert de propriété et de jouissance dans les trois ans. Ce faisant, la cristallisation, conférée par la non-opposition à déclaration préalable – non contestée à l’époque – a bénéficié au permis de construire de ce dernier lot, puisque son acquéreur avait lui-même acquis dans le délai de trois ans, les trois premiers lots, qui n’étaient pas à bâtir. Ce « portage » des premiers lots, peut-être à peu de frais, s’est avéré finalement fort utile.
Cette façon de procéder, possible pour les opérateurs quand le ou les propriétaires acceptent de céder leur unité foncière par tranches, devrait se développer en pratique. Sous réserve de prendre quelques précautions pour que le permis d’aménager ou la déclaration préalable intégrant des lots non bâtis ne soient pas sérieusement contestables…